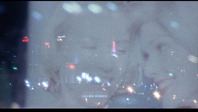1.1. Une réalisation à l’unisson du propos
1.2. La clef des songes
1.3. Le cinéma : une réalité illusoire
1.4. Le « Club Silencio » ou l'artifice et la disparition : une illustration de la condition humaine
1. Analyse
Mulholland Drive apparaît comme une illustration filmée de l’aphorisme de Calderòn : « La vie est un songe dont la mort sonne le réveil.» (Calderòn)
David Lynch emprunte la Mulholland Dr. pour nous conduire jusqu’au cœur palpitant du mythique Hollywood. A travers un film sur l’endroit et l’envers de la Cité de l’illusion - miroir étincelant de la célébrité et/ou nécropole des rêves brisés - qui est magnifié par une réalisation empruntant sa matière même à l’artifice de la « fabrique à rêves », il nous propose une métaphore de la condition humaine écartelée entre désirs, rêves et réalité.
1.1. Une réalisation à l’unisson du propos
L’histoire qui sous-tend Mulholland Drive a le mérite apparent de la simplicité : Diane Selwyn, une jeune actrice ambitionne une carrière d’actrice à Hollywood, mais ses espoirs de réussite et sa vie amoureuse sont une suite d’échecs. Confinée dans des rôles secondaires et jalouse d’être trompée par son amie Camilla Rhodes qui, de son côté, est devenue une vedette, elle décide de la faire assassiner. Pourtant, à l’inverse de ce récit qui relève du cliché, le réalisateur organise une mise en images en forme de puzzle qui privilégie la complexité : qu’il s’agisse, en effet, de l’ambiance musicale insolite, du récit fragmenté qui bouleverse la chronologie, de personnages qui semblent être en quête d’une identité incertaine, d’une époque mal définie ou d’une géographie des lieux qui privilégie le passage et l’errance, le film semble placé sous le signe – Hollywood oblige - de l’artifice, du provisoire et de l’inachevé.
Un univers musical intemporel
L’emploi récurrent de morceaux des années cinquante et soixante – comme dans Blue Velvet [1] ou Mystères à Twin Peaks [2] - brouille les repères chronologiques et donne au film une dimension étrange de « déjà vu », propre à suggérer l’intemporalité du propos. C’est ainsi que les danses échevelées du pré-générique (le jitterbug) évoquent l’âge d’or hollywoodien des années cinquante au cœur d’un film censé se dérouler aujourd’hui même, dépaysant ainsi le spectateur.
Un récit fragmenté qui bouleverse la chronologie
Un dépaysement aggravé par un récit qui n’a que les apparences de la linéarité. Pendant près de deux heures, David Lynch filme en effet l’histoire édifiante d’une jeune femme, Betty Elm, venue à Hollywood pour devenir « une grande actrice et une star ». Mais la dernière demi-heure s’attache à montrer les zones d’ombre de cette vie, voire la descente aux enfers de l’héroïne, contredisant les images montrées jusque-là. Bref, la chronologie des faits vole en éclats au profit du souci constant du réalisateur d’épouser le fil sinueux d’un psychisme en souffrance fragmenté entre ses désirs, le réel et l’imaginaire. Au final, Mulholland Drive est composé comme un diptyque en ce qu’il offre au spectateur un double rêve emboîté : le rêve d’avenir prometteur (Diane à Hollywood/Echec de sa carrière – Diane amoureuse de Camilla/rupture douloureuse) et le rêve a posteriori de compensation (la re-création d’un passé hollywoodien où tout lui sourit, succès et amour). La déconstruction du récit place ainsi la deuxième partie du film (Histoire de Diane) chronologiquement avant ce qui la précède (Diane est devenue Betty). Ainsi l’illusion précède-elle le ressentiment, et le bonheur, le désespoir. Mais le montage des séquences n’épouse pas la moindre linéarité ; ce qui contribue à entremêler rêve et réalité en faisant interférer entre elles certaines séquences pourtant situées à des moments différents. (1)
Un retour en arrière - également non linéaire - s’inscrit même dans la deuxième partie et les repères temporels disséminés dans le film entretiennent la confusion entre les deux histoires comme le montrent les deux exemples suivants. Lorsque Diane se trouve au Winkie’s en compagnie du tueur chargé d’éliminer Camilla (138ème mn), son regard croise celui de Dan le rêveur dont le cauchemar est sans doute en train de se constituer avant qu’il ne le tue (17ème mn). Par ailleurs, la visite de Betty et Rita à Santa Bonita (96ème mn), sur la trace de Diane Selwyn, nous apprend, selon les dires de sa voisine, « son absence depuis plusieurs jours. » Or, cette même voisine informe Diane (118ème mn), avec qui elle a échangé son appartement, qu’elle souhaite récupérer ses affaires : « Allez, Diane, ça fait trois semaines. » Autrement dit, le film installe deux temps en parallèle, comme pour faire écho à la symétrie des deux histoires et mieux basculer du rêve à la réalité, ou inversement. Ou encore pour nous maintenir dans un même monde ambigu. Bref, ce que le spectateur considère comme le présent du film n’est, en fait, qu’une représentation imaginaire du passé, du présent et/ou d’un futur possible nés d’une expérience douloureuse qui est, elle, bien réelle. C’est ainsi que Mulholland Drive construit un univers éminemment sensoriel où réel et rêve ont une même existence.
Des personnages en quête d’identité
Cette déconstruction du récit s’accompagne d’une décomposition d’identité pour ce qui est des personnages principaux. Mulholland Drive entretient le trouble avec ses personnages aux noms doubles comme dans l’univers du cinéma où les acteurs portent des noms d’emprunt : Diane décide d’être Betty, comme se nomme la serveuse du Winkie’s ; Camilla, de façon encore plus explicite, sera Rita comme l’actrice, Rita Hayworth, de l’affiche du film Gilda qu’elle a sous les yeux. Et le film devient confusion de deux récits aux personnages à la fois identiques et différents qui apparaissent et disparaissent dans un décor changeant et provisoire où ils ne sont que de passage.
Une géographie de la ville caractérisée par le passage et l’impasse
C’est la Mulholland Dr. qui ouvre le film sur l’accident initial responsable de l’amnésie de Camilla et/ou marque le début de rêve de Diane. Cette route mythique qui serpente sur les hauteurs de Los Angeles permet d’observer la ville à distance. Et ce qu’en montre la caméra de Lynch dès les premières minutes procède d’une double vision. D’une part, deux plans en plongée donnent à voir la myriade des lumières nocturnes, comme autant de signes attirants de vie et de promesses de bonheur. D’autre part, un plan prolongé cadre longuement le regard de l’inspecteur Harry McKnight, appelé peu après sur les lieux de l’accident, en train de fixer précisément les innombrables lumières de la ville depuis la même route : mais ce second plan, à la différence du premier, semble porter un jugement pour le moins plus réservé dans la mesure où le visage du policier, contemplant la ville et le sentier qu’a emprunté Camilla, exprime gravité, doute et inquiétude.
La plongée du papillon Camilla attirée par les éclats artificiels d’Hollywood comme le regard circonspect de l’inspecteur symbolisent d’emblée ce qui est au cœur même du film, une dualité de l’envers et l’endroit qui se propage à l’ensemble de Mulholland Drive.
Dans le film, Los Angeles est souvent filmé la nuit en plongée depuis Mulholland Dr., mais aussi de jour en panoramique en plongée verticale. Puis la géographie de la ville est tracée de façon détaillée et très réaliste (Lynch filme même les plaques des noms de rue !) et oppose les lieux de la réussite (la résidence de la tante Ruth ou la villa d’Adam Kesher) et ceux du malheur (Sierra Bonita et ses deux appartements échangés n° 12 et n° 17) ; les centres d’affaires (les studios Ryan) et de vie (l’Avenue Franklin, Sunset Bd, le Winkie’s, Hayvenhurst et l’aéroport, l’avenue bordée de palmiers, enfin).
Le va-et-vient entre ces lieux semble ordonné selon une boucle dans la mesure où ils sont visités à plusieurs reprises, à l’exception de l’aéroport lors de l’arrivée de Diane - ce qui semblerait suggérer que l’on vient à Los Angeles, mais que l’on n’en repart pas. Les autres éléments du décor apparaissent et/ou réapparaissent toujours de façon inattendue au cours du récit. Par exemple, chaque scène au Winkie’s modifie notre perception de l’histoire en cours : d’abord associé à Dan, le rêveur obnubilé par son cauchemar, il devient le siège de l’enquête de Betty et Rita et, in fine, le cadre où Diane conclut le meurtre de Camilla avec le tueur. De même, la résidence Sierra Bonita, où se rendent les deux femmes à la recherche de Diane Selwyn - la possible identité de Rita - pour y découvrir un cadavre en décomposition, reparaît à la toute fin du film pour servir de décor au suicide de Diane/Betty. Les lieux, dans Mulholland Drive, ne cessent de nous conduire dans des impasses. Notamment en ce qui concerne les lieux de vie des personnages qui n’apparaissent que pour marquer un passage ou une fin. Ainsi Betty/Diane s’installe-t-elle chez sa tante, mais Diane/Betty réside à Sierra Bonita - et déménage de l’appartement n°12 à l’appartement n° 17. De son côté, Rita/Camilla erre de Mulholland Dr. aux rues de Los Angeles, de chez Betty à la villa d’Adam Kesher sans jamais être montrée dans un domicile personnel fixe - signe évident de sa non existence. Cette absence durable de cadre intime, cette « circulation » permanente de personnages sans cesse en mouvement, fait, à l’inverse, du Winkie’s, pourtant lieu public de transit par excellence, le point central qui se substitue à la sphère privée : cet apparent paradoxe est bien le signe de personnages qui ne sont que de passage et dont l’identité est toute virtuelle.
Ainsi le même lieu se recouvre-t-il des strates de deux histoires emmêlées, ce qui confère à chaque décor - éphémère mais récurrent - un côté mystérieux, voire inquiétant. Et « le club Silencio », cadre insolite surgi de nulle part et proclamant l’artifice, apparaît à point pour nous ramener à la dimension intérieure des êtres. Le traitement de l’espace, dans Mulholland Drive, comme celui du récit et des personnages, ainsi qu’on l’a déjà signalé, plonge le spectateur, désorienté et déphasé, dans l’ambiguïté et le faux-semblant, l’éphémère et l’errance. Il ne lui reste plus, comme alternative à cette instabilité, qu’à partager les émotions des personnages et, ce faisant, à se plonger en lui-même pour « entendre » son âme.
1.2. La clef des songes
Entre-temps, le film déroule un récit mêlant rêve et réalité, en apparence inextricablement liés. Le cadre d’Hollywood, cette « usine à rêves », l’art cinématographique, cette « fabrique d’illusions » et l’ambition d’une jeune femme « désireuse de devenir une vedette » se combinent pour créer un film fascinant sur la confusion entre le principe de réalité et le pouvoir de l’imaginaire, qui finit par créer le malheur.
« Amour, gloire et beauté ! » scandent les rêves de Diane qui se concrétisent les uns après les autres : histoire sentimentale et sensuelle avec la belle Rita ; révélation de son talent et reconnaissance unanime de la profession lors de son essai réussi, voire succès auprès du réalisateur Kesher attiré par la jeune femme.Mais la Mulholland Dr. peut conduire du paradis des rêves à l’enfer du cauchemar. L’épisode des deux amis du Winkie’s est, à cet égard, révélateur : Dan raconte à son ami le cauchemar qu’il a fait avec ce lieu comme décor et il entend confronter en sa compagnie les éléments de son rêve (un être immonde et effrayant qui surgit) avec la réalité : il voit bien l’être cauchemardesque qui hantait ses nuits, mais il en meurt. Cette séquence, toute symbolique, semble signifier qu’il est dangereux de vouloir vivre ses rêves.
N’en est-il pas de même pour Diane qui, dans son désir de réussite, et fascinée par la légende d’Hollywood, en a méconnu la réalité de « miroir aux alouettes » illustré dans le film par les lumières étincelantes dans la nuit qui attirent la Laura amnésique, voire par ces lettres géantes (HOLLYWOOD) qui s’inscrivent régulièrement à l’écran ?
Ce goût de Lynch pour la métaphore se retrouve dans la présence insolite de deux objets récurrents dans le film : la clé et le cube. La clé est liée à l’assassinat de Camilla et le symbolise ; elle renvoie Diane à la réalité de la mort de Camilla. Quant au cube, également bleu, il « matérialise » le rêve de Diane : la renaissance de Camilla en Rita et de Diane en Betty. Ce double rêve emboîté : le rêve d’avenir prometteur (bonheur de Diane à Hollywood/douleur de l’échec de sa carrière – Diane amoureuse de Camilla/rupture en forme de désespoir) est un rêve de compensation a posteriori (la re-création d’un passé hollywoodien où tout lui sourit, succès et amour). Mais il ne fait nul doute qu’il répondait à une aspiration préalable. La dernière demi-heure du film, par une sorte de retour au passé, se construit de nouveau sur le contraste et mêle illusions et désillusions : trois niveaux de sens structurent le film qui empile désirs de gloire d’une jeune fille naïve, réalité de l’échec et volonté de compenser en rejouant sa vie pour l’enjoliver.
1.3. Le cinéma : une réalité illusoire
Par ailleurs, le cube et la clé sont les signes d’une mise en abyme à l’intérieur du film : le drame que vit Diane et son refuge dans le rêve fait écho à la dualité de l’art cinématographique, créateur d’illusions présentées comme la réalité. Ainsi que l’écrit le critique Michel Mouret en 1959 : « Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs... »
Ce monde « magique » évoqué ici par le critique a sa représentation symbolique dans les figures de la clé et de la boîte bleues. La clé, comme on l’a dit plus haut, symbolise l’assassinat de Camilla puisqu’elle renvoie Diane à la réalité de la mort de Camilla. Quant au cube, il « matérialise » le rêve de Diane : la renaissance de Camilla en Rita et de Diane en Betty. En ce sens, objets éminemment métaphoriques, ils évoquent bien la recréation de la réalité qu’opère l’art cinématographique. Mais, comme le mot « Fin » qui s’inscrit inéluctablement sur l’écran noir, ces objets ouvrent sur le vide et le néant par le retour à la réalité triviale du quotidien, lorsque Laura se saisit de l’un (la clé) pour entreprendre d’ouvrir l’autre (le cube) : il s’ensuit aussitôt un travelling avant dans la boîte bleue accompagné d’un glissement sonore et suivi d’un fondu au noir (115ème mn). C’est alors une nouvelle version de l’histoire de Betty, celle de Diane et de son échec, qui commence – ou, plutôt, qui va s’achever dramatiquement.
Diane qui va « rêver » une vie plus « heureuse » et conforme à ses désirs n’est-elle pas l’incarnation même du réalisateur qui construit une illusion sur la réalité ? David Lynch permet à Diane de « faire ainsi son cinéma » (auteur du scénario, elle dirige son propre rêve, le met en scène et dirige les acteurs dont elle est l’actrice principale et le personnage central) et construit un film dans le film, suggérant que toute oeuvre d’art relève d’un parti pris de fabrication. A l’instar d’Andrew Niccol dans S1mOne [3], 2002), il donne ainsi à voir un film qui est réflexion sur la matière même de son film. Cette dualité – déjà explorée par le réalisateur dans ses œuvres précédentes – s’inscrit à tout moment dans Mulholland Drive, que ce soit dans la double identité des personnages de Diane alias Betty et de Camilla alias Rita ; dans un récit déconstruit qui confond habilement réalité et rêve jusqu’à égarer le spectateur et « l’obliger » ainsi à participer au film ; et dans une citation du passé du cinéma dans le présent même du film, celui-ci étant alors considéré comme un simple moment d’une histoire plus large, celle du Cinéma.
S’inspirant sans doute du Psychose [4] d’Hitchcock dont la construction en deux parties et la substitution d’un personnage à l’autre avait à l’époque surpris (1- Histoire de Marion/2– Histoire de Norman), Lynch propose donc une structure semblable en deux parties également pour deux personnages, mais qui sont, en fait, le même se rêvant un autre (1– Histoire imaginaire de Betty-Diane/2– Histoire réelle de Diane). Jouant à la fois sur les figures de l’identique et du contraire, David Lynch nous plonge dans un univers fascinant parce que nous le ressentons visuellement et musicalement, mais aussi en ce qu’il nous échappe sans cesse par son étrangeté.
Ainsi le réalisateur rattache-t-il entre elles, au cours du film, des séquences chargées de sens qui entrent en résonance pour mieux nous perdre et nous éclairer, selon la dualité qui caractérise les films de Lynch. Après le violent accident initial sur Mulholland Dr., Lynch filme (7ème mn) Rita, seule et amnésique, empruntant un sentier qui descend vers Los Angeles ; puis, une séquence identique (125ème mn) inverse le schéma : Rita redevenue Camilla accueille Diane (ex-Betty) et la guide dans un sentier qui s’élève au-dessus de Los Angeles. Ces deux séquences jumelles s’expliquent l’une par l’autre : la violence de l’accident peut symboliser le choc émotionnel que ressent Diane à la mort de Camilla et représente la soudaine mise en œuvre d’un processus de négation de cette réalité insupportable. Se met alors en place un rêve complexe de compensation à ses déboires : la « descente » de Camilla évoque précisément la plongée de Diane dans son rêve de gratification ; à l’inverse, la « montée » en compagnie de Camilla annonce à la fois le sommet de la trahison de celle-ci qui va lui révéler son mariage avec Adam, mais aussi la prochaine « sortie » du rêve et le retour à la sinistre réalité. Ainsi Lynch utilise-t-il les figures contraires de l’ immersion (descente de Rita/plongée dans le rêve de Diane) et de l’ émersion (ascension des deux amies/montée vers la vérité et extraction du rêve pour Diane) - comme le faisait Hitchcock dans Psychose [5] (du panoramique aérien sur l’hôtel qui abrite le bref bonheur de Marion et de Sam à l’extraction finale de la voiture du marais qui entérine la sordide vérité de la mort de la jeune femme) - pour mieux donner à voir la dialectique du Bien et du Mal qui préside à toute vie.
Enfin, Mulholland Drive propose des références au cinéma dans le film même : ainsi en est-il de la figure du « Cow-boy » ou encore du « Tueur à gages », personnages obligés et récurrents d’un certain cinéma hollywoodien.
L’affiche même du film de Charles Vidor, Gilda (1946), qui tapisse un mur, est longuement filmée. On peut rappeler, par ailleurs, la claire référence au Boulevard du crépuscule [6] (1950) de Billy Wilder ; au film de Godard (2) Le Mépris (1963) et au En quatrième vitesse de Robert Aldrich, voire à Il était une fois en Amérique [7] de Leone et, comme on l’a déjà précisé, au Psychose [8] (3)
Mais il ne s’agit sans doute pas d’un simple hommage cinéphile. L’utilisation de ces références semble plutôt accréditer l’idée que Mulholland Drive est né de la matière même des films ci-dessus évoqués : leur vision, comme celle de toute œuvre d’art, a impressionné le réalisateur et laissé une trace durable dans sa sensibilité et son intelligence. Ces films sont ainsi devenus une part de lui-même et ont vécu dans sa mémoire, en gestation, jusqu’à faire naître son propre film, en une sorte de prolongement naturel à ce qui l’a précédé.
1.4. Le « Club Silencio » ou l'artifice et la disparition : une illustration de la condition humaine
Ce sentiment de désillusion qui parcourt le film et conduit jusqu’au meurtre et au suicide naît visuellement dès l’entame du film dans les images radieuses de « la jeune fille » chaperonnée par « le vieux couple ».
Ce couple âgé entrevu à trois reprises dans le film (au générique, puis lors de l’arrivée de Diane à Los Angeles et lors de l’ultime séquence précédant le suicide de Diane) incarne l’une des énigmes du film. Au générique, il semble participer au succès du concours de danse qu’il a peut-être organisé et qui est sans doute gagné par Diane. Ce qui expliquerait sa présence dans l’avion qui débarque Diane à Los Angeles (l’homme et la femme l’ont-ils conseillée à tenter sa chance à Hollywood ?) - il est vrai que la vieille femme, Irène, l’appelle Betty et que la scène est une reconstruction onirique opérée par Diane. Mais le regard et les mimiques sarcastiques qu’ils échangent entre eux, une fois qu’ils ont quitté Diane et sont installés dans la limousine hollywoodienne, laisse à penser qu’ils anticipent l’échec et la désillusion de Diane et qu’ils ont trompé sa confiance.
On peut aussi voir en lui l'émanation du choeur antique qui dans les tragédies grecques, commentait les événements selon une morale traditionnelle. Dans le film, le couple qui accompagne Diane, se félicite de ses ambitions, anticipe son échec et lui porte le coup de grâce, incarne ainsi le destin de la jeune femme.
On peut estimer enfin que ce couple âgé représente, d’une façon générale, les adultes (parents ou personnes à qui leur âge donne une certaine expérience de la vie), au sens large du terme, par opposition aux adolescents (inexpérimentés et nourris des rêves les plus fous) et qu’ils sont considérés comme les responsables des rêves illusoires des enfants. En l’occurrence, ne sont-ils pas les pourvoyeurs de cette machine à broyer qu’est cet Hollywood-Minotaure exigeant son tribut de jeunes gens ? Du début du film où ils chaperonnent Diane à la fin qui les montrent tels des démons – libérés par le clochard du Winkie’s – venant harceler Diane et la pousser au suicide, la métaphore est claire : ils sont bien les « mauvais génies » à l’origine du destin fracassé de la jeune femme.
Dès lors, si l’on rapproche Mulholland Drive, Blue Velvet [9] et Mystères à Twin Peaks [10], on s’aperçoit d’une évolution notable. Alors que dans Blue Velvet [11], les parents jouent leur rôle et s’efforcent de prévenir – certes, parfois, en vain - Jeffrey et Sandy des dangers qui menacent les adolescents hors du foyer familial, Mystères à Twin Peaks [12] insiste, à l’inverse, sur la présence du mal au cœur même de la famille : on songe, bien sûr, à Laura et à son abominable géniteur, mais aussi à Audrey Horne sur le point d’être confondue par son père avec une nouvelle prostituée… à essayer ! Avec Mulholland Drive s’amorce une étape supplémentaire sur le chemin du mal, qui installe les figures récurrentes des adultes aux moments clés du destin de l’héroïne pour la conduire à sa perte : notamment lors du concours de danse (le Jitterbug), à l’aube d’une carrière brillante, et immédiatement avant son suicide provoqué, semble-t-il, par leur présence démoniaque. David Lynch choisit le burlesque pour filmer cette ultime présence des adultes autour de Diane : d’abord montrés comme des figures lilliputiennes, puis en très gros plans de visages déformés. Le réalisateur insiste ainsi symboliquement sur leur pouvoir à la fois exagéré (très gros plans de visages grotesques) et dérisoire (plans de personnages nanifiés qui les fait passer pour des marionnettes insignifiantes). Des représentants adultes inadéquats et inutiles… dont la mort de Diane porte pourtant trace de leur importance dans sa courte existence : ce sont eux qui acculent la jeune femme devenue adulte au suicide ; mais une adulte redevenant, dans la mort, ce corps couché dans la position fœtale de l’enfant, en un saisissant raccourci de toute une vie.
On ajoutera que la mort de Diane n’est pas sans rapport avec celle de Laura dans Fire walk with me [13]. La même ambiguïté préside en effet aux deux séquences. La fin bouleversante de Fire Walk with me [14] - sublimée par une partition musicale inspirée (musique de Cherubini) - en forme d’ascension angélique rédemptrice, est si peu conforme au propos du film qu’elle laisse pour le moins désemparé : faut-il la comprendre à travers son apparente beauté formelle ? Ne s’agit-il pas, au contraire, d’un ultime et cruel sarcasme lancé aux tenants d’un au-delà qui adoucirait les injustices de ce monde ? De la même façon, les images qui succèdent au suicide de Diane, musicalement illustrées par la tragique gravité du Love Theme (4) composé par Angelo Badalamenti, font naître une étrange impression de paix sereine, alors même que la mort de la jeune femme ressortit au sordide le plus évident. Le film s’achève par la surimpression des figures blanches de Betty/Diane et Rita/Camilla sur les lumières de Los Angeles ; ce halo hollywoodien renvoie bien à l’ascension lumineuse de Laura Palmer.
On pourrait dire que, blotti au coeur de son cinéma, le spectateur contemple, ému et retenant son souffle, les images de Lynch, mais qu’il ressent confusément toute la précarité et la réversibilité d’émotions où le tourment alterne avec un apaisement transitoire. Avant de pressentir que le chemin où une Camilla - déjà morte - conduit une Diane - qui va mourir - au désert et à l’artifice du Club Silencio est celui même qui mène un jour toute conscience à la révélation douloureuse de ce qu’est la condition humaine : la disparition. « La vie est un songe dont la mort sonne le réveil. » (Calderòn)
Mulholland Drive est bien ce film sur un Hollywood présenté comme la métaphore de la condition humaine, c’est-à-dire l’univers dérisoire de nos désirs « humains, trop humains ». Et si illusoires...
Notes :
(1) Les indices signifiants jalonnent le film et l’on peut en évoquer quelques-uns parmi les plus intéressants, ne serait-ce que pour illustrer le propos du réalisateur.
Ainsi la clé bleue qui est découverte, dans la voiture accidentée, par les deux inspecteurs symbolise le contrat sur Camilla passé par le tueur ainsi que sa mort (9ème mn). Mais elle évoque tout aussi bien la clef du songe qui ouvre sur la vie rêvée par Diane. On la retrouve d’ailleurs dans le sac du clochard (138ème mn), lui-même associé au cauchemar de Dan. Elle sert, enfin, à Camilla pour ouvrir la boîte bleue (115ème mn) qui clôt le rêve de Diane et la renvoie à la triste réalité de sa vie.
Lorsque Diane se trouve au Winkie’s en compagnie du tueur qu’elle charge d’éliminer Camilla, son regard croise celui de Dan (138ème mn) sans doute en train de nourrir son cauchemar à venir. Cette rencontre avec celui qui est mort (depuis la 17ème mn) d’avoir vu se réaliser son rêve est le point de jonction spatial de trois destins : le meurtre programmé de Camilla, le suicide à venir de Diane tenaillée de remords et la mort de Dan dans l’arrière cour du Winkie’s.
Par ailleurs, le passé rêvé que Diane est en train d’élaborer est aussitôt présenté comme tel par le réalisateur ainsi que le montre l’indice suivant. Dès l’arrivée de Diane à Los Angeles, Irène, la vieille dame, se répand en propos élogieux convenus quant à l’avenir de la jeune femme ; pourtant, dès qu’elle se retrouve avec son mari, dans une limousine noire, le regard moqueur qu’elle échange avec lui peut se lire comme le signe de leur satisfaction d’avoir abusé de la crédulité de Diane. Et ce regard est sans doute à interpréter comme celui même de Diane qui intervient a posteriori dans le récit – en construisant son rêve -, une fois qu’elle a compris combien elle a été le jouet d’un Hollywood de rabatteurs prêt à exploiter la naïveté des apprentis vedettes. Le même jugement péjoratif poussé jusqu’à la vengeance accumule, du point de vue de Diane, les mésaventures subies par Adam Kesher. La limousine noire dans laquelle s’installe le vieux couple au sortir de l’aéroport, symbolise bien ce mirage hollywoodien de la réussite et confirme le rôle de prédateur au service du système hollywoodien que joue le couple. : cette scène n’est-elle d’ailleurs pas une re-création imaginé a posteriori par Diane qui règle ainsi ses comptes, comme elle le fera, sans doute, en se représentant les mésaventures d’Adam Kesher.
Un autre exemple est tout aussi révélateur : au cours de son errance amnésique Camilla trouve refuge chez ce qui sera présenté plus tard comme la résidence de la tante de Betty. Sur le point de quitter sa demeure, la supposée tante de Betty se retourne vers la porte d’entrée encore ouverte au moment précis où le spectateur voit s’y introduire la future Rita (11ème mn), mais elle ne manifeste aucune réaction, preuve qu’elle n’a rien vu et que Rita n’existe pas sinon dans le rêve de Betty.
Un dernier exemple concerne Rita qui, à deux reprises, propose à Betty de la suivre pour une double déconvenue. C’est, d’abord, elle qui la guide jusqu’à la villa d’Adam pour lui révéler cruellement la fin de leur amour. C’est, ensuite, toujours elle qui la conduit (« Il faut qu’on aille quelque part. », lui dit-elle) jusqu’au Silencio, dont le nom (Silence) et la localisation spatiale (un parking désert) évoquent fort à propos le silence et le vide, c’est-à-dire un lieu où l’on disparaît, comme Camilla, puis Betty,… dans la mort.
(2) D’une part, la ressemblance entre Godard jeune et Adam Kesher est tout sauf anodine comme le montrent les deux photos ci-dessous illustrant le rapprochement déjà évoqué dans l’analyse. D’autre part, le dialogue entre le Cow-boy aux ordres des producteurs hollywoodiens et le réalisateur Kesher souligne clairement la malice de Lynch si l’on rappelle la réputation de cinéaste intellectuel et volontiers critique qui est celle de Godard.
Ainsi, au Cow-boy qui demande à Kesher de réfléchir, ce dernier répond qu’il réfléchit, ce que met en doute le Cow-boy lui précisant que réfléchir n’est pas faire le bel esprit : « - Le cow-boy : Il faut réfléchir/- Kasher : Je réfléchis/- Le Cow-boy : Tu fais trop le malin pour réfléchir. »
(3) Les citations de films jalonnent Mulholland Drive. La plus évidente, Boulevard du crépuscule [15] (1950) de Billy Wilder, est explicitement cité par David Lynch qui filme les studios Paramount (Bronson Gate) devant laquelle se présente une Betty émerveillée ; on y voit une même voiture ancienne devant la même entrée, cinquante années plus tard. (73ème mn 48 secondes). Plus subtilement, David Lynch emploie dans son film Ann Miller, ancienne Reine des claquettes, qui y incarne Mme Lanois (Catherine ou « Coco »), comme Billy Wilder faisait jouer son propre rôle à Gloria Swanson.
Les thèmes du film de Godard, Le Mépris (1963), - les démêlés d’un réalisateur avec son producteur et la naissance d’une jalousie conjugale mortelle – établissent un lien avec le film de David Lynch. On notera, de même, un autre élément commun : Godard achève son film par le mot « Silenzio », comme Lynch fait prononcer le mot « Silencio » dans le Club du même nom.
Par ailleurs, ce téléphone qui sonne dans le film à plusieurs reprises sans que le combiné ne soit décroché renvoie au film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique [16] (1984), avec la même force tragique du rappel obsédant d’un passé que l’on ne peut plus changer. Ce dernier film, tout comme Mulholland Drive, ne s’achève-t-il pas - comme il a commencé - par la vision d’un De Niro plongé en plein rêve et le film ne peut-il être considéré comme le contenu même de ce rêve ?...
Les désopilantes – et dramatiques - mésaventures du tueur malchanceux condamné à multiplier les meurtres pour éliminer les témoins qu’il multiplie accidentellement semblent sorties tout droit du cinéma de Tarantino, et notamment de Pulp Fiction [17] aux tueurs, terrifiants mais hilarants de maladresse et de sottise.
Enfin, la présence de la boîte bleue mystérieuse et celle des tueurs du début du film de Lynch, évoquent le thriller de Robert Aldrich, En quatrième vitesse (1955). On y croise également, dès l’entame du film, une jeune femme menacée sur une route nocturne, avant que n’apparaisse, plus tard, une boîte - le cube bleu comme une réminiscence ? - qui, ouverte, déclenche une explosion cataclysmique.
(4) Ce Love Theme, adagio aux lentes circonvolutions musicales soulignées de basses rampantes, qui escorte la voiture noire serpentant sur la route nocturne suggère une forme d’inquiétude mélancolique, d’autant plus qu’un bref intervalle de rupture marqué par un accord dissonant et l’effacement momentané des basses sonnent comme une fêlure propre à suggérer un malaise, voire une discrète plainte. Le thème, qui reprend ensuite avec force, se ressent alors comme l’accompagnement musical funèbre de ce corbillard noir qui glisse dans l’obscurité sur la Mulholland Dr., avant qu’il ne suive la descente aux enfers de Diane.
2. Synopsis détaillé
Arrivé chez lui, Adam constate la présence d’une fourgonnette de service ; il entre dans la maison à la recherche de sa femme Lorraine, qu’il trouve dans le lit en compagnie du propriétaire de la fourgonnette. Sans dire un mot, il s’empare du coffret à bijoux de Lorraine qui l’insulte et le remplit de peinture. L’amant le frappe et Lorraine le met à la porte. Adam remonte dans sa voiture et s’en va. [52mn30]
Un taxi amène une Betty aux anges pour son audition jusqu’aux studios Paramount. Très paternaliste, voire obséquieux et mielleux, M. Brown, le réalisateur, la présente à l’équipe de tournage et à l’acteur principal, Woody Katz, qui doit lui donner la réplique. Le jeu de Betty lui vaut force éloges. Mais, quittant les lieux en compagnie de la productrice, elle entend critiquer son partenaire. La productrice veut lui faire connaître un réalisateur de génie : Adam Kesher. Dans un studio voisin, une chanteuse, Carol, enregistre filmée précisément par Adam qui fait passer une audition à une autre chanteuse, Camilla Rhodes, qu’il choisit conformément à ce qui lui a été demandé. Betty éprouve un vrai coup de foudre à la vue d’Adam, mais s’éclipse en pensant à Laura qui attend son retour pour se rendre chez Diane Selwyn. [1h27mn40] Betty et Laura arrivent en taxi au n° 2590. Laura ne reconnaît pas les lieux, mais prend peur en découvrant deux hommes dans une voiture en stationnement, et Rita oblige le conducteur du taxi à faire un détour par l’arrière. Toujours inquiète, Rita s’effraie inutilement à la vue d’un homme. Les deux femmes arrivent devant l’appartement n°12. Une femme ouvre la porte qui précise qu’elle a échangé son habitation avec Diane Selwyn et que celle-ci habite au n°17 avant d’ajouter qu’elle est absente depuis plusieurs jours. Elle se propose de les accompagner, mais un coup de téléphone l’oblige à rentrer chez elle. Betty tire la leçon de la rencontre : Rita n’est pas donc Diane Selwyn. Au n°17, personne ne répond et Betty décide de s’introduire dans le logement par une fenêtre mal fermée. Puis elle ouvre, de l’intérieur, la porte à Rita. Une odeur épouvantable règne dans l’appartement où gît un cadavre de femme. Betty empêche Rita de hurler pendant que la voisine frappe à la porte. Les deux femmes jaillissent hors de l’appartement et leurs images, par un effet de superposition, semblent se troubler. [1h36mn48]
Quand elle se retourne, Betty a disparu et Rita commence par l’appeler, puis par la chercher avant d’apercevoir le sac de Betty qu’elle ouvre et en extrait la clé bleue qui lui permet d’ouvrir la boîte bleue qui est vide. Un travelling avant dans la boite accompagné d’un glissement sonore est suivi d’un fondu au noir. [1h55mn28] La boîte tombe sur le tapis de la chambre. La caméra filme le couloir où apparaît Ruth la tante de Betty : elle jette un regard sur le lit fait et le tapis vide. [1h56mn20] Après un fondu enchaîné ponctué de sons graves, la caméra donne à voir une jeune femme couchée, qui semble être le cadavre découvert par les deux amies, pendant que se montre le « Cowboy » lui demandant de se réveiller. Le « Cowboy » referme ensuite la porte. [1h56mn40] Un fondu au noir ponctué de coups frappés à une porte précède la vision de Betty allongée dans la même position que le corps précédent. Les coups insistent et Betty se réveille difficilement. Ce n’est pas la chambre de sa tante, c’est celle occupée par Diane Selwyn. Précisément, c’est la voisine de Diane Selwyn qui lui demande de lui rendre ses affaires empruntées depuis trois semaines et elle l’appelle Diane. En récupérant ses affaires, elle voit la clé bleue. Puis elle sort en l’informant que les deux détectives sont revenus. Restée seule, Betty/Diane semble désespérée jusqu’à ce qu’un sourire illumine son visage : elle vient de voir Rita, qu’elle appelle Camilla et dont elle se réjouit du retour. Mais ce n’est qu’une illusion : elle est bien seule et prépare son petit déjeuner. [2h01mn25] Un gros plan sur une cafetière saisie par la Diane déprimée précède la vision illusoire du passé où Betty rejoint Rita nue étendue sur le divan. Mais Rita demande à Betty de cesser ses caresses déclenchant la fureur de son amie : « C’est lui. » lui répond Betty. [2h03mn30] Betty est filmée en train de regarder Adam Kesher diriger une scène avec Rita. Il se glisse à ses côtés dans la voiture et demande que le plateau de tournage se vide. Rita obtient que Diane (Betty) puisse rester. Adam explique à l’acteur comment il doit s’y prendre pour consoler le personnage joué par Rita qu’il embrasse avec une envie partagée par l’actrice sous le regard d’une Betty désemparé par la « trahison » de son amante. [2h05mn25] Après un fondu au noir, s’ensuit une brève scène de dispute entre les deux femmes au cours de laquelle Betty/Diane exprime jalousie et menaces avant de refermer violemment la porte sur Rita. Une porte qui fait transition avec la scène suivante où Betty/Diane pleure sa souffrance et s’adonne mécaniquement au plaisir solitaire. [2h07mn] Un téléphone sonne qui renvoie à une scène passée : un appel lui propose une voiture pour se rendre au 6980, Mulholland Dr. [2h83mn15] Comme au début du film, l’image d’une voiture qui gravit une route est illustrée du même thème musical : mais à l’arrière, ce n’est pas la future Rita amnésique, mais Betty devenue Diane. Bientôt, le chauffeur arrête le véhicule au grand étonnement de Diane.
Dans une lumière bleutée de brume et d’éclairs apparaissent les lumières nocturnes de Los Angeles sur lesquelles, en surimpression, s’inscrit le visage en image blanche de la Betty des jours heureux associé ensuite à celui de Rita en blond. Un ultime fondu enchaîné dévoile la scène du Club Silencio : la femme aux cheveux bleus du Club Silencio filmée en plan américain murmure le mot « Silencio »… [2h22mn30]
3. Fiche technique
- Titre : Mulholland Drive.
- Réalisation et scénario : David Lynch.
- Année : 2001.
- Durée : 2h26mn.
- Musique : Angelo Badalamenti, David Lynch et John Neff.
- Directeur de la photographie : Peter Deming.
- Directeur artistique : Peter Jamison.
- Décoratrice : Barbara Haberecht.
- Montage : Mary Sweeney.
- Production : Les films Alain Sarde, StudioCanal, Asymmetrical Prod.
- Distributeur : France Bac Films.
Distribution :
- Naomi Watts : Betty Elms/Diane Selwyn.
- Laura Elena Harring : Rita/Camilla Rhodes.
- Justin Theroux : Adam Kesher.
- Ann Miller : Catherine « Coco » Lenoix.
- Dan Hedaya : Vincenzo Castigliane.
- Lori Heuring : Lorraine Kesher.
- Angelo Badalamenti : Luigi Castigliane.
- Brent Briscoe : Détective Neal Domgaard .
- Robert Forster : Détective Harry McKnight.
- Katharine Towne : Cynthia Jenzen .
- Lee Grant : Louise Bonner .
- Monty Montgomery : Le cowboy.
- Melissa George : Camilla Rhodes blonde.
- Billy Ray Cyrus : Gene.
- Chad Everett : Jimmy Katz .
- Rita Taggart : Linney James.
- Wally Brown : James Karen.
4. Edition Blu-Ray
L'image proposée laisse le spectateur le plus bienveillant sur sa faim : un léger voile est souvent présent. Toutefois les scènes sombres sont bien restituées
Le son (piste VO DTS-HD MA 5.1), si important dans les films de David Lynch, est excellent, qui met en valeur bruitages et thèmes musicaux avec une grande précision.
  
| Les droits de ce document sont régis par un contrat Creative Commons et plus précisement par le contrat Creative Commons Paternité - Partage des Conditions Initiales à l’Identique Licence France 2.0 de Creative Commons, plus connue sous le nom de "CC-BY-SA". |
Droits d'auteur © Henri PHILIBERT-CAILLAT
5. Bande annonce
par catégories
par mots-clés
par dates d'ajout et de modification
Index alphabétique
Partagez vos connaissances !
Pour publier durablement et librement sur Internet, contactez-nous.
AURORAE LIBRI : livres anciens, textes rares & illustrés modernes
VINTAGE-ERA : informatique vintage, retro gaming, jeux de rôles et imprimés des années 1970-2000
Libre Savoir a 17 ans.
Suivez-nous : RSS Twitter
© 2000-2016, AURORÆ Solutions, tous droits réservés. – site animé avec notre logiciel C3IMS.